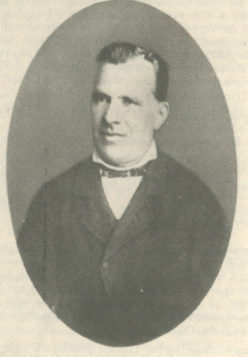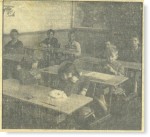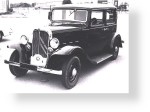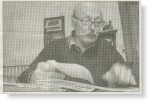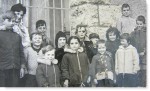L’ECOLE A
SAMOGNEUX
(cliquer sur les images
pour les agrandir)
Un peu d’histoire.
Si
on examine les registres paroissiaux, tenus par les curés, avant la Révolution,
on se rend compte que la plupart des habitants de Samogneux savaient écrire,
sûrement lire et au moins signer correctement et lisiblement leur nom:
de 1686 à 1690 il y eu 22 mariages, sur ces 22 mariages 18 hommes ont
signé leurs noms et 11 femmes ont signé, de 1786 à 1790
il y eu 7 mariages, sur ces 7 mariages 6 hommes ont signé leurs noms
et 6 femmes ont signé, de 1816 à 1820 il y eu 10 mariages, sur
ces 10 mariages 10 hommes ont signé leurs noms et 9 femmes ont signé,
et toujours de belles écritures est-il précisé.
Dans le contexte politique du moment, forts d’afficher
une certaine différence sociale, certains d’entre eux intégrèrent
les conseils révolutionnaires, d’abord, puis municipaux. Ceci aux
environs de 1790.
Avant cette période, sous l’ancien
régime, il n’y avait, laisse entendre l’histoire, pas d’écoles
dans les campagnes françaises. Pourtant, la notion religieuse était
prépondérante, bien des petits villages, des hameaux, furent sans
doute des lieux d’instruction !
Concernant Samogneux, on peut affirmer grâce à
des documents contenu dans le pouillé scolaire l'existence d'une école
presbytérale depuis 1681 jusqu'en 1789, mais on peut penser que ces écoles
sont bien plus anciennes. C'est une série de régents qui assuraient
l'enseignement à Samogneux.
Le régent, placé sous l'autorité du
curé de la paroisse était embauché par la communauté
paroissiale avec l’accord de l’évêque de Verdun qui
n’accorde les "lettres de régence"
qu’après "enquête sur la moralité"
du postulant et sur contrôle de ses connaissances religieuses. Les familles
devaient payer à ce régent un droit "d’écolage"
et ces écoles ne transmettent que les connaissances élémentaires
: catéchisme, lecture, écriture, bases du calcul.On appellait
aussi ces maîtres d'école des "chauffe-fesses"...les
connaissances devaient être intégrer côute que côute,
même à coups de trique si nécessaire...
En effet, depuis très longtemps déjà
l’église avait comme prérogative, d’instruire, en
particulier depuis la révocation de l’édit de Nantes et
suite à une déclaration royale de Louis XIV le 13 décembre
1698, adressée aux protestants convertis et enjoignant les paroisses
d’ouvrir des écoles primaires, surtout pour les enfants de ces
ex-protestants…
Louis XIV était bien conscient que les adultes,
nouveaux catholiques, ne renieraient pas aussi facilement leurs convictions
religieuses mais que leurs enfants seraient plus facilement gagnés à
la religion par l’enseignement et l’instruction religieuse, le catéchisme.
Ce qui explique et on le comprend facilement, que parfois en fin de journée
des parents tentaient secrètement de convaincre leurs enfants du non-sens
de la religion catholique.
Pour tenter d’éradiquer le protestantisme,
ces lieux d’enseignement étaient souvent chez un régent
ou au presbytère, c’était vraisemblablement le cas à
Samogneux et dans les environs, sous la haute autorité ecclésiastique
de l’évêché de Verdun. Le maître très
souvent installé par le curé et payé par lui, enseignait
le calcul, la lecture et l’écriture.
Cela permettait au curé aussi de détecter,
c’était surtout cela qui l’intéressait, des vocations
ecclésiastiques et si d’aventure des dispositions intellectuelles
étaient avérées, l’élève était
pris en charge, orienté, pour grossir les rangs du clergé. Certaines
familles pauvres rencontrèrent là, possibilité pour leur
enfants de s’élever dans l’échelle sociale et d’accéder
à une vie meilleure.
En France,
la notion de transmission des connaissances au peuple : l’enseignement
remonte à Charlemagne tout le monde à entendu cela à l’école…
L’école, auparavant, était exclusivement
réservée à ceux qui avaient une vocation ecclésiastique.
Dans sa grande majorité, la noblesse d’alors lui préférait
les arts de la guerre, plus virils.
Charlemagne ayant un empire très vaste décide
de former des administrateurs et pour cela il crée des écoles
où seront enseignés les textes sacrés, en particulier l’école
du Palais, où il demande à nombre de sommités de venir
enseigner. A l’enseignement initial du sacré il fait ajouter le
calcul et l’astronomie.
Ces écoles, seront placées dans les cathédrales
de l’Empire et les monastères. Il émet des ordonnances dans
ce sens et l’Eglise demande que chaque cathédrale ouvre une école,
laquelle recevra uniquement dans son sein des jeunes destinés à
une carrière ecclésiastique.
Plus tard l’école se démocratise
un peu. A cette époque et durant des siècles l’enseignement
est fait uniquement par des religieux : des prêtres et des abbés.
Dans les monastères ce sont des moines qui officient.
Charlemagne, très catholique et défenseur
de l’Eglise était lui-même avide de savoir, considérant
qu’il avait pour mission de conduire son peuple au salut, le clergé
instructeur et instruit doit aussi enseigner aux laïcs. On apprend à
lire sur des textes sacrés, sans notion d’alphabet, déjà
cette foutue méthode globale…La connaissance des prières
sera la base de tout, l’Empereur espère ainsi que les enfants pourront
indirectement instruire les parents.
Dans les campagnes les paroisses n’étaient
pas très riches. Les enfants écrivaient sur le sol avec ce qu’ils
pouvaient, les plus fortunés avaient une petite besace en cuir fixée
à la taille, contenant l’ancêtre de nos ardoises, en fait
une planchette écritoire recouverte soit de cire d’abeille soit
de chaux, un stylet et non un stylo…en bois, os ou métal permettait
de tracer les caractères. L’âge de raison étant fixé
par l’Eglise à 7 ans, c’est l’âge auquel les
enfants commençaient à aller à l’école, et
ce, durant 4 ou 5 ans.
Jusqu’au XII° siècle environ, les plus
riches, comme les seigneurs, pouvaient offrir à leurs enfants des précepteurs,
enseignant sur place moyennant quelques espèces sonnantes et trébuchantes.
Certains envoyaient leurs rejetons dans des monastères, les moines en
échange de l’enseignement obtenaient de l’or, très
souvent des terres, origine des propriétés immobilières
de l’Eglise. L’élève ne devenait pas systématiquement
religieux, d’autres parents offraient leur enfant aux religieux, mais
dans ce cas pour être moine, il était donc instruit, nourri et
logé. Ceci tout au long de l’ancien régime.
La révolution allait changer cela. Tout d’abord
les dirigeants transposèrent le modèle religieux à cette
nouvelle époque. Comme les religieux, les républicains veulent
modeler les esprits des enfants à la cause révolutionnaire. L’enseignement
est remanié dans l’état français, sous la surveillance
des autorités révolutionnaires en place. Le progrès, bien
compris par les dirigeants, a imposé l’enseignement pour tous.
Au début les classes se sont gonflées démesurément
et le maître était bien seul, aussi à certains endroits
connaissant ces situations, sont choisis quelques bons élèves
qu’on appelait des moniteurs. Il n’existait pas de cahiers et très
souvent les élèves ont à leur disposition une table recouverte
d’une couche de sable fin dans lequel ils traçaient les caractères.
Tous ces changements ont fait que l’alphabétisation
a beaucoup progressé dans le peuple au XIX° siècle.
En 1833, François Guizot, Ministre de l’Instruction
Publique, a organisé l’École par une loi qui porte son nom
et rendait obligatoire l’établissement dans chaque commune d’au
moins une école primaire publique, chaque département une Ecole
Normale.
Les instituteurs, pour enseigner, devaient posséder
un brevet de capacité : il leur fallait savoir lire, écrire, compter
et être « en état de bien montrer ces trois choses ».
Pour les écoles, un programme d’enseignement était prévu
: instruction morale et religieuse, lecture, écriture, éléments
de la langue française et de calcul, système légal des
poids et mesures, très utile pour commercer.
La loi prévoyait aussi la gratuité
pour les plus pauvres. Un tiers des élèves en bénéficiait.
Les grandes oubliées de cette loi ont été les filles :
rien n’était prévu pour elles. Les autres grands défauts
de cette loi étaient qu’elle ne rendait pas l’école
obligatoire et ne parlait pas de la gratuité pour tous. Encore quelques
décennies et tout s’arrangera.
Jules Ferry, Ministre de l'Instruction publique de 1879
à 1883 établit la gratuité de l'enseignement primaire par
la loi du 16 juin 1881, promulgue une loi qui rend l’école obligatoire
le 29 mars 1882, dont un extrait, l’art.4 : "l'instruction primaire
est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de 6 ans révolus
à 13 ans révolus ; elle peut être donnée soit dans
les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les
écoles publiques ou libres, soit dans les familles par le père
de famille lui même ou par toute personne qu'il aura choisie".
 |
Il
a préalablement laïcisé cette école en 1880,
voici un extrait de sa déclaration à l’Assemblée.
« Messieurs, le Gouvernement pense que la neutralité religieuse
de l'école, au point de vue du culte positif, au point de vue confessionnel,
comme on dit en d'autres pays, est un principe nécessaire qui vient
à son heure et dont l'application ne saurait être retardée
plus longtemps.(...) Je vous demande de vous tenir dans la doctrine qui
est la doctrine de la liberté de conscience, de l'indépendance
du pouvoir civil, de l'indépendance de la société
civile vis-à-vis de la société religieuse. »
Il prit des mesures énergiques à
l’égard des enseignants religieux. Le 29 mars 1880, Jules
Ferry prend deux décrets par lesquels il ordonne aux Jésuites
de quitter l'enseignement dans les trois mois.
Il donne aux enseignants des congrégations
catholiques non autorisées le même délai pour se mettre
en règle avec la loi ou quitter aussi l'enseignement. 5.000 congrégationnistes
sont presque aussitôt expulsés. |
À
l'aube de la III° République et avant que n'intervienne Jules Ferry,
la France est déjà un pays fortement alphabétisé.
C'est ainsi qu'aux environ de 1870, plus de 80% des nouveaux mariés sont
en mesure de signer le registre de mariage dans le nord et l'est du pays, donc
évidemment à Samogneux.
A Samogneux comme dans beaucoup de communes françaises
c’est le moment où les mairies se posent la question. « Où
et quand construire une école publique , voire la mairie-école
» ?
A Samogneux elle était située en face
de l'ancienne maladrerie qui était dénommée "Le château",
actuelle maison Ségalla, adossée au talus qui borde le chemin
menant au monument aux morts ( voir les cartes
postales anciennes). De nos jours, si on s’approche un peu
on peut apercevoir affleurant du sol, dans ce talus, quelques pierres, ce qui
reste de l’édifice.
C'est sous Louis Philippe, celui qu'on appelait le roi
citoyen, en 1842, que la municipalité se décide à se doter
d'une vraie école, sous l'impulsion de la loi Guizot, de juillet 1836,
qui impose aux communes de plus de 500 habitants de financer une école
de garçons et de filles, Samogneux n'avait alors que 250 habitants environ,
mais les élus ont voulu anticiper.
Un terrain libre de construction, puisqu'en verger,
appartenant à Mr Etienne Rigobert Warnet est l'objet d'interêt.
La parcelle se trouve entre le lavoir et une maison, elle forme un grand triangle
de 222 centiares.
Des pourparlers s'engagent, sur la base d'une
somme de 400 Frs, majorés de 88,33Frs pour le notaire, 74,36 Frs pour
l'avoué et 30 Frs pour l'architecte, soit un total de 592,69 Frs. Le
préfet de la Meuse donne son aval le 16 février 1844, la commune
a à ce moment-là en caisse, 6002,18 Frs, ce qui permettra de payer
le terrain et les 2/3 de la construction du bâtiment.
Les travaux commencérent à l'été
1844, en vue d'une rentrée scolaire en 1845, et se terminérent
l'été 1845, restait à trouver un instituteur, c'est
Nicolas Arnoult qui inaugurera la salle de classe à la fin de
l'été 1845.
Ce bâtiment comportant un étage, comprenait:
au rez-de-chaussée, l’école communale, sur la gauche, en
allant vers Brabant, le préau et une petite cour, et à l’étage,
la mairie, où l'on accédait par le chemin montant à l'église.
A cette époque, la rentrée scolaire
se faisait le 1° Octobre jusqu'au 14 Juillet, "des foins aux vendanges"..
on avait besoin des enfants pour les travaux des champs.. 6 heures d'école
par jour, sauf le jeudi et le dimanche, de 9 heures à midi et de 13 heures
à 16 heures, vacances de Pâques et de Noël, n'excédant
pas une semaine..
Jusqu'à la
guerre de 1914, voici la liste de tous les instituteurs ayant exercé
à Samogneux.
- Arnoult
Nicolas, né à Auzéville le 9 Juillet 1808
, décédé à Samogneux le 13 Avril 1862, exercera
de 1845 jusqu'en juillet 1860.
- Nicolas
Laurent, né à Cumiéres le 27 Février
1819, décédé le 21 Novembre 1890 aux Eparges, exercera
de 1861 jusqu'en juillet 1874.
- Pierre louis Moreau,
né le 1° Novembre 1833 à Cesse (55), exercera jusqu'en
juillet 1877
- Nicolas Prospére Gillet,
né à Cumiéres le 16 Janvier 1837, décédé
le 10 mars 1900 à Ecurey en Verdunois Meuse, à l’âge
de 63 ans exercera jusqu'en juillet
1882.
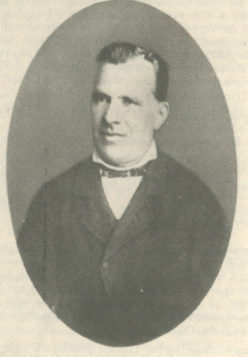 Photo
famille Gillet, Québec. Photo
famille Gillet, Québec.
- Marie Gabriel Aimé Migeon,
né le3 Avril 1859 à Béthincourt, décédé
en 1900, exercera jusqu'en juillet 1885
- Jean Louis Nivromont,
né à Bezonvaux le 25 Octobre 1857, décédé
à Samogneux le 3 Juin 1901
- Emile Pierre Bastien,
né à Mogeville le 5 Juin 1868, exercera jusqu'à
juillet 1914, il fut en particulier, le maître de Gaston
Thiébaut.
|

Collection
Claude Thiébaut
Photo de classe 1902 Samogneux, instituteur, Mr Bastien,
au 1° rang, 4° en partant de la gauche, en robe avec une croix,
Gaston Thiébaut
|
Le 26 Octobre 1936, l'école
va réouvrir, et les institutrices ou instituteurs qui se succéderont
jusqu'à nos jours, sont évoqués ci-aprés.
000000000000000000000000000000000000
Après
la guerre de 1914-1918 et la reconstruction de la Mairie-école à
laquelle la généreuse donatrice américaine Miss Horace
Gray avait participé, grâce à la vente en Amérique
de la traduction du « Père Barnabé » d’Henry
Frémont, et qui s’était terminée en 1931, le problème
fut le manque d’élèves potentiels.
En effet,
la plupart des habitants, agriculteurs de leur état, qui étaient
revenus au village à la fin des hostilités, afin de reprendre
leurs exploitations, se virent en majorité expropriés par la mise
en « zone rouge ». Leurs surfaces cultivables, truffées d’engins
explosifs et jugées trop dangereuses, ils n’auront d’autre
solution que d’aller s’installer dans d’autres communes.
Samogneux enfin reconstruit se retrouva avec un nombre
insuffisant d’enfants pour rouvrir l’école, pourtant équipée
d’un matériel complet, du dernier cri ; avec bibliothèque
et bains douches…dotés de 4 cabines individuelles avec chaudière,
le nec plus ultra à l’époque. La culture américaine
en matière d’hygiène était omniprésente, mais,
hélas, seule l’épouse du maire l’étrenna, la
douche ne faisant pas partie des us et coutumes locales à l’époque.
En attendant l’arrivée d’autres enfants,
les cinq, seuls scolarisables : Georges Burkard et son jeune
frère Charles, Roger Albert, son frère
Pierre (le père de Madame Lecrique habitant actuellement
prés de l’église à Samogneux)et Robert Jacques,
fils du maire de l’époque, furent dirigés vers l’école
de Régnéville, l’autre côté de la Meuse, distante
de 800 mètres.
Cela dura jusqu’en 1935, avec tous les inconvénients
inhérents au trajet, aux intempéries, aux crues de la Meuse coupant
la circulation sur le chemin reliant les deux villages, submergé pendant
des semaines en hiver.
Jusqu’au jour où de nouveaux habitants
arrivèrent avec des enfants d’âges scolaires. Il s’agissait
de la famille Lecointe, mes grands-parents, Robert et Germaine, venant en novembre
1935, de Brabant sur Meuse où ils avaient un petit café (la dernière
maison à gauche en sortant du village en direction de Consenvoye) et
ayant fait l’acquisition du café de Samogneux. Les deux enfants,
Jacques et son petit frère Roland, portaient le nombre de jeunes scolarisables
à 7, or le nombre minimum d’enfants requis pour ouvrir une école
à cette époque était de 7… Mon grand-père
qui était un homme énergique et remuant, sollicita aussitôt
la municipalité pour qu’elle relance l’administration de
l’éducation nationale, afin d’obtenir la réouverture
de l’école. De plus, à la même époque , était
en poste un garde forestier, Monsieur Madier, originaire de Montmorillon (86),
dont l’épouse était institutrice…en disponibilité…une
aubaine.
Mon grand-père s’était entretenu
avec cette dame, qui était tout à fait d’accord pour reprendre
du service. Fort de cet argument, les élus, la mairie, le conseiller
général Gaston Thiébaut, le député
André Beauguitte, que mon grand-père connaissait
bien, pesèrent de tout leur poids sur le dossier.
Tant et si bien que l’école fut réouverte
début 1936. Madame Madier exerça quelques mois,
puis son mari, le garde forestier, se fit muter dans sa région d’origine,
Montmorillon, elle céda sa place à Madame Fassinot.
Cette institutrice a fait l’école jusqu’en
1937. Entre temps une nouvelle famille était venue s’installer
à Samogneux, la famille Giraud, qui avait 4 enfants scolarisés
et qui occupait le logement de fonction de l’enseignant, au dessus de
l’école. La salle de classe unique était bien garnie. Mais
la famille Giraud n’est restée qu’un an à Samogneux
et a libéré le logement.
Madame Boïeldieu, la nouvelle
institutrice l’a aussitôt occupé. Picarde d’origine
comme mon grand-père Lecointe qui était de la région d’Amiens,
berceau de la famille, tous deux aimaient échanger quelques conversations
en patois picard…ce qu’ils ignoraient, mais que moi j’ai découvert
50 ans plus tard, c’est qu’ils avaient un lien de parenté…
En 1938, Monsieur Boïeldieu, militaire de son état, cantonné
à Verdun est muté, sa femme quitte son poste d’institutrice
et est remplacée par Madame Masson.
C’est cette même année, 1938, que
de nouveaux arrivants au village apportent à l’école une
nouvelle enfant. Il s’agit de l’éclusier, Raymond Durand,
Noémie sa femme et Andrée leur petite fille âgée
alors de 8 ans, qui sera plus tard ma maman…Mes grands-parents maternels
arrivaient de Givet dans les Ardennes où mon grand père fut barragiste
pendant plusieurs années. Originaires de Sivry sur Meuse tous les deux,
mon grand-père souhaitant se rapprocher, venait d’être nommé
à l’écluse de Samogneux.
Madame Masson, l’institutrice,
elle aussi femme de militaire a exercé jusqu’à la mutation
de son mari en 1940, elle quitte Samogneux en début d’année.
L’école ferme ses portes à nouveaux
en raison des hostilités et de l’évacuation des habitants,
l’exode. Quelques-uns sont rentrés quelques temps plus tard, entre
autres mes grands-parents maternels; en qualité de fonctionnaire employé
au canal, l’administration contraignit mon grand père à
reprendre son poste à l’écluse, malgré l’interruption
de la navigation.
Pour 17 longues années l’école restera
fermée. Les quelques rares élèves présents : Charles
Burkard et ma mère, la fille de l’éclusier, sont contraints
d’aller à l’école de nouveau à Régnéville.
Cette situation ne dura que quelques semaines car le 12 juin 1940 le pont reliant
les deux villages est détruit par l’armée française
ainsi que celui de l’écluse.
Les enfants sont donc dirigés sur l’école
de Champneuville, ils empruntaient pour s’y rendre le chemin de halage
le long du canal. Après quelque temps, Charles Burkard cesse définitivement
sa scolarité. Seule ma mère continue à fréquenter
la classe de Champneuville. J’ai bien écrit « la classe »,
car en réalité l’enseignant utilisait les élèves
pour son usage personnel, son jardin, dégermer ses patates, ramasser
les doryphores dans son champ de pommes de terre, écosser les haricots,
bref un personnage qui n’avait pas une haute idée de sa mission
et peu digne d’occuper cette fonction.
Cette situation dura une partie de la guerre, puis en 1945 ma mère fut
dirigée à Nancy, au collège.
L’école de Samogneux resta donc fermée
durant plusieurs années, du reste il n’y avait plus d’enfants
scolarisables. La mairie permit à un voisin d’utiliser la salle
de classe comme poulailler, avec ce que cela implique comme dégradation
du local et l’appartement de fonction fut loué à un ancien
gendarme en retraite, membre du conseil municipal.
LA REOUVERTURE DE
L’ECOLE
Cette
situation devait se prolonger jusqu’en 1956, date à laquelle, certains
membres du conseil municipal, dont mon père, Jacques Lecointe, qui avait
un enfant bientôt scolarisable, moi même, né en 1950, prirent
conscience du fait que la commune courrait à sa disparition à
plus ou moins brève échéance si l’école ne
rouvrait pas. Entre temps le maire donna sa démission et mon père
lui succéda.
La nouvelle équipe municipale fit du dossier
« école » son objectif prioritaire et la décision
de tout faire pour rouvrir l’école, clé de toute la commune,
fut prise.
Cela constituait un défi presque insurmontable,
mais ceux qui ne tentent rien n’ont rien...
L’opération comprenait plusieurs critères
et non des moindres : premièrement récupérer et remettre
en état la salle de classe, compte tenu de son utilisation détournée
récente. Le plafond de la pièce était éventré
par des infiltrations d’eau dues à une détérioration
du vasistas se trouvant sur le toit, celui-ci avait en effet été
fracassé par des retombées occasionnées par la destruction
à l’explosif du pont de l’écluse en juin 1940 et jamais
réparées. L’appartement situé au-dessus, avait quant
à lui été refait à neuf ainsi que le trou dans le
plancher dû à la gouttière, avec les fonds destinés
à la réparation des dommages de guerre, persuadée qu’était
la municipalité que l’école ne rouvrirait jamais. Mais ce
logement était toujours occupé, le locataire avait eu son congé
et devait libérer les lieux.
Le deuxième critère, faire venir des ménages
jeunes avec enfants, constituait à lui seul une gageure dure à
tenir. Mais c’était sans compter sur la détermination du
nouveau maire en place qui fit connaître par voie de presse les possibilités
en matière de travail et de logement.
Par chance un poste de fonctionnaire était à
pourvoir, celui de garde forestier, avec maison de fonction. Il y avait aussi
quelques maisons de libres : le presbytère, près de l’arrêt
de bus, l’actuelle maison de Roland Dabit, qui venait d’être
entièrement remise en état par la commune.
En attendant
l’ouverture de l’école, en 1956, trois enfants du village
étaient scolarisés dans des villages voisins. Il s’agissait
de Jean Louis et Gérard Dabit, frères aînés de Roland,
qui allaient à Brabant sur Meuse, à pied, et moi-même qui
allais à Champneuville transporté par mon grand père Durand
à mobylette, même sur le verglas…
Fin d’année 1956, un maçon venant
des Vosges, Eugéne Euriez et sa femme, avec 4 enfants dont 1, scolarisable,
Daniel qui occupèrent le presbytère. Claudine et Jean Paul le
seraient l’année suivante.
Deux ménages de militaires américains
habitant le village, avaient eux aussi de jeunes enfants. La famille Pennington,
qui résidait où habite Jean Marie Addenet, le maire actuel, avait
une petite fille Tawn (Tanny) de 5 ans et la famille Larsen « Dop »
et Hélène, qui elle, logeait dans l’actuelle maison Barber
et qui avait deux garçons, Larry, 10 ans et Jimmy 4 ans, Jimmy était
déjà notre camarade de jeux ; nous tâtions déjà
du lancer de base-ball à Samogneux...Cette famille était originaire
de la région de Shreveport en Louisiane. La famille Jacques Robert et
Madeleine, seuls cultivateurs de Samogneux, avait quant à elle deux enfants,
Joëlle et Alain. Enfin début d’année 1957, Antoine
Ségalla et sa femme Arlette emménagent avec deux enfants, Pierre
et Maryse.
Venant de terminer un intérim à Chauvençy-le-Château,
un tout jeune instituteur remplaçant, Christian Théron, prit le
poste à Samogneux en janvier 1957.
Il fut trés longtemps maire de Lachalade, en Argonne.
Toutes les conditions étaient enfin réunies
pour la réouverture de l’école, les travaux de remise en
état étaient terminés, seul le mobilier scolaire moderne
n’était pas encore arrivé, qu’à cela ne tienne,
les anciens pupitres feraient l’affaire pour le démarrage.
C’est le 21 janvier 1957 que l’école
a rouvert ses portes avec tout d’abord 6 élèves.
|
Le jour de la rentrée,
le 21 janvier 1957.
Monsieur Théron avec à sa gauche
à l'arriére plan, Gérard Dabit,
Jean Louis Dabit, Michel Lecointe & au 1°
plan Alain et Joëlle Jacques et Roland
Dabit.
|
Puis
aux vacances de Pâques le nouveau garde forestier, Lucien Jacq, est arrivé
de Woël dans la Woëvre pour prendre son poste avec cinq enfants, dont
3 scolarisables, Claudine, Robert et Pierre. La rentrée de Pâques
a été une explosion, nous nous sommes retrouvés à
14 élèves.
|
On
peut reconnaître, en arriére plan, Christian Théron
notre jeune instituteur barbu en compagnie de Jacques Lecointe, le maire.
Au premier rang, de gauche à droite,
Alain Jacques encapuchonné, Daniel Euriez, Maryse Ségalla,
Pierre Jacq, Joëlle Jacques, Roland Dabit, Tawn Pennington, Gérard
Dabit.
Au deuxième rang, de gauche à
droite, Robert Jacq, Michel Lecointe, Claudine Jacq, Pierre Ségalla,
Larry Larsen et le dernier au centre à droite de Christian Théron
Jean Louis Dabit. Une belle brochette…et une belle revanche contre
la fatalité. |
Nos deux
camarades américains,
Tawn Pennington et Larry Larsen
parfaitement intégrés, parlaient de mieux
en mieux le français. |
|
Cette
école a été une découverte pour nous tous, et quels
souvenirs ! La cour en terre battue, fermée par une grille s’est
mise à retentir de cris d’enfants. Les jeunes se fréquentaient
peu auparavant dans le village, avec les nouveaux venus se fut l’effervescence.
Exploration du préau, qui à l’époque
abritait, sur la gauche, coté rue, la pompe à incendie à
bras, type Laffly Mle 1886, peinte en rouge avec des liserés noirs et
dorés, ses roues en bois à rayons. Un mur de briques de 2 mètres
de haut face au portail, séparait le jardin de l’instituteur de
la cour. Puisqu’il était interdit de l’escalader, c’était
évidemment la transgression favorite, comme pour la pompe…
 Monsieur Théron ne pouvant accéder
au logement de fonction encore occupé par le locataire à la recherche
d’un autre appartement à l’extérieur de Samogneux,
était hébergé chez mes parents dont l’établissement
faisait hôtel. Il prenait ses repas avec mes parents et moi, je le côtoyais
donc toute la journée…mais je n’en garde que d’excellents
souvenirs. Cette situation a duré plusieurs mois.
Monsieur Théron ne pouvant accéder
au logement de fonction encore occupé par le locataire à la recherche
d’un autre appartement à l’extérieur de Samogneux,
était hébergé chez mes parents dont l’établissement
faisait hôtel. Il prenait ses repas avec mes parents et moi, je le côtoyais
donc toute la journée…mais je n’en garde que d’excellents
souvenirs. Cette situation a duré plusieurs mois.
Notre jeune maître d’école nous a
pris en main et ce n’était pas triste en particulier avec Pierre
Ségalla qui était, bien que très bon élève,
très turbulent et qui jetait à travers la classe tout ce qui lui
passait par les mains, sans se laisser impressionner le moins du monde par les
réprimandes et punitions à répétition qui s’abattaient
sur lui.
Plusieurs
tranches d’âges et de niveaux étant mélangés
dans cette classe, l’ambiance était assurée. Mais
le travail se faisait tout de même et cette formation de base nous
a, à tous été bénéfique, la pédagogie
de notre instituteur était payante et plaisante. |
|
Ce
qui ne gâchait rien, c’était « l’exotisme »
de Monsieur Théron ; originaire de l’Aveyron, de Rodez, son accent
chantant nous séduisait. De plus, il avait comme passion, la mécanique,
contaminé par son garagiste de père, il retapait et améliorait
des guimbardes des années 30, type Peugeot 201 et Rosalie plus puissante,
parfois il pilotait aussi quelques motocyclettes, c’était une véritable
attraction dans le village…Sa
conduite hors norme et sportive nous offrait continuellement de véritables
shows qui ne faisait que renforcer l’admiration que nous avions pour lui.
Les
voitures de notre instituteur.. en 1957.
La 201. |
|
et la
Rosalie
|
|
Dans le courant de l’année 1957, le mobilier nouveau arriva : pupitres
en bois clair et tube d’acier, avec porte cartables et toujours les encriers
en faïence, deux par tables, car à cette époque on écrivait
encore à la plume. L’encre, de couleur bleue, était fabriquée
par le maître dans une bouteille munie d’un bec verseur, il fabriquait
aussi l’encre rouge, qui lui était destinée exclusivement,
pour les corrections des devoirs.
Il ne fallait pas que cette encre gèle l’hiver ni nous non plus…
et pour cela la salle était chauffée par un vieux poêle
à charbon placé à l’avant de la classe, à
droite de l’estrade. L’allumage était folklorique; notre
bricoleur de maître utilisait de l’huile de vidange répandue
sur du bois et du papier dans le foyer du fourneau. C’était non
seulement radical, mais un vrai cérémonial qui nous distrayait
beaucoup le matin en arrivant, le chauffage n’était pas activé
avant notre entrée en classe. L’année suivante un chauffage
au fuel fut installé. La salle de classe n’en fut que plus agréable
à l’arrivée des enfants le matin. Je me souviens aussi que
durant l’hiver 1957-1958, le froid avait gelé le canal, la navigation
a été interrompue ; les péniches étaient prises
par les glaces. Sur l’une d’elle une famille de mariniers avait
deux enfants, un garçon et une fille, qui sont venus à notre école
pendant une semaine environ.
Fin 1957, une autre famille arriva de Vacherauville,
Stéphane et Nicole Barber, avec trois enfants, dont deux scolarisables,
Josiane qui était de décembre 1950 et Alain. Pour la rentrée
en septembre 1957 nous étions seize élèves…
En 1958
notre bon maître a été nommé à Fleury sur
Aire. Est arrivée à sa place une institutrice, Nelly Maillard.
Monsieur
Théron coulait, en 2005 encore, et depuis quelques années,
une retraite bien active…il était très impliqué
dans la vie associative locale, toujours à Lachalade où
il fut maire pour son septième mandat depuis 1965. Dans ce cadre,
il s’est distingué en 1989, avec un conseil municipal majoritairement
féminin, 7 femmes et 2 hommes, le prix Marianna a été
décerné à cette municipalité qui a su reconnaître
le mérite des femmes et leurs qualités dans ce genre d’aventure.
Derniérement, le 01/02/2007, il a été promu dans
l'ordre des Palmes Académiques au grade de Chevalier, et ce, par
décret du Ministre de l'éducation Nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche. Il est décédé
en novembre 2011.
|
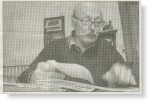 |
Madame
Maillard était mariée et avait une fille, Catherine, qui a intégré
la classe.
Le style a radicalement changé, l’approche avec
les élèves aussi. Nelly Maillard était très compétente
mais sans patience et colérique, sa fille Catherine entre autres en faisait
les frais tous les jours. Vraisemblablement pour ne pas être taxée
de favoritisme. Ah! Pour nous changer, cela nous a changés. Les punitions
pleuvaient. Puis petit à petit l’adaptation s’est faite.
C’est cette année, en avril 1958 que la
famille Addenet, André et Christiane Addenet avec 4 enfants dont 3 scolarisables
vint s’installer à l’écluse, mon grand-père
partant en retraite. Marie Christine, Jean Marie et Dominique grossirent les
rangs de notre école.
Entre temps l’école de Régnéville
a dû fermer pour cause d’effectif insuffisant, les quelques rescapés
de ce village vinrent nous rejoindre, il y avait Viviane Trouslard, Patrice
et Yves Albert et Jean-Claude Chaplier, Roger Pigeard, Françoise et Françine
Gentil.
Nos camarades américains étaient partis,
leurs parents étant mutés, bref nous nous retrouvions tout de
même à 25 élèves.
Dans la cour en mai
1961 . |
|
Certaines
mamans participaient en quelques occasions aux activités de l’école,
à Noël par exemple, en parfaite entente avec Madame Maillard. Le
dernier après midi de classe avant les vacances de fin d’année,
les tables étaient disposées en L , des mamans apportaient des
confiseries et autres douceurs, du chocolat chaud était préparé,
qui embaumait le lieu et on faisait la fête, prés du sapin décoré.
Noël
1958, on peut reconnaître, tout à gauche derrière
Maryse Ségalla, madame Maillard, prés du sapin, madame Andrée
Lecointe et à droite, Madame Madeleine Jacques. Il manque les enfants
de Régnéville, une crue de la Meuse les empêchant
de venir en classe. |
 |
 |
Petite fête organisée
par Nelly Maillard à Noêl 1959; sur scéne à
gauche Robert Jacq donne la réplique à Michel Lecointe en
compagnie d'Alain Jacques. On peu reconnaître Marie-Christine Addenet
dans l'ouverture de la porte.
(collection:Pierre
Jacq)
|
Novembre
1959,
prés
du portail. |
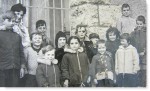 |
L’école
a donc très bien fonctionné durant quelques années avec
la scolarisation de tous les enfants qui arrivaient, grandissaient. Des naissances
chez Euriez, Migeotte-Dabit, Addenet, Ségalla, Lecointe ont participé
à garder l’école ouverte durant ces années. Nelly
Maillard est restée en poste jusqu’en 1967.
La relève
a été assurée par une nouvelle arrivante, Monique Spagnolo,
qui venait d'exercer à Cierges près de Montfaucon d’Argonne.
Durant
8 ans l’école a continué de fonctionner, grâce aussi
avec des enfants de Régnéville, en particulier, Francis Gentil,
François et Dominique Chaplier, Serge et Martine Albert. A Samogneux
les derniers élèves à fréquenter l’école
communale ont été, Maryse Lecointe, ma sœur, Patrick, Françoise
et Chantal Migeotte, Pascal Barber, Sylvie, Françine, Marie-Ange et Marie-Pierre
Addenet, Aline Ségalla, Bernadette et Françoise Euriez. A l’issue
de leur scolarité en primaire les enfants partaient au fur et à
mesure en cycle secondaire à Verdun.
Une
petite fête en 1969, avec madame Spagnolo. On peut reconnaître
à gauche Maryse Lecointe, Dominique Addenet, Marc Albert, au premier
plan à gauche Dominique Chaplier, Françine Addenet, Martine
Albert, devant elle, une petite Euriez et enfin à droite Chantal
Migeotte. |
|
La
constitution dans les années 70, d’un Syndicat Intercommunal Scolaire
regroupant plusieurs communes, entre autres Consenvoye et Forges, sonna le glas
de notre école. Monique Spagnolo termina sa mission en juin 1975, et
est nommée à Charny au groupe scolaire, où elle terminera
sa carriére, il y eu encore 2 ans d'école à Samogneux avec
deux enseignants et elle ferma définitivement ses portes en 1977. Ainsi
se termine une aventure qui nous a apporté beaucoup pour notre éducation,
et quels souvenirs !!
Il est
peu probable que l’école communale de Samogneux puisse un jour
rouvrir, ayant été depuis une dizaine d’années transformée
en logements de rapport par la municipalité ; des studios dans la salle
de classe et dans l’ancien local dédié aux douches publiques,
placé à droite de la mairie ainsi que le grand et bel appartement
de fonction situé à l’étage.
Copyright
Samogneux - 2004 ©